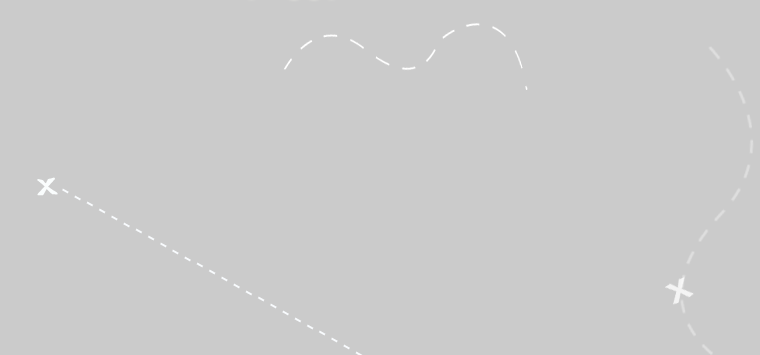
Autour de soi, on sent bien que la modernisation rime avec uniformisation. Un pareil style de vie s’impose d’un bout à l’autre de la planète, répandu par les médias et prescrit par la culture de masse. De la Paz à Ouagadougou, de Kyoto à Saint-Pétersbourg, d’Oran à Amsterdam, on visionne les mêmes films, on regarde les mêmes séries télévisées, on nous présente les mêmes informations, les mêmes chansons, les mêmes slogans publicitaires, les mêmes objets, les mêmes vêtements, les mêmes voitures, le même urbanisme, la même architecture, le même type d’appartements souvent meublés et décorés d’une manière identique… La diversité cède progressivement le pas devant la foudroyante offensive de la standardisation, de l’homogénéisation, de l’uniformisation. Dans l’histoire de l’humanité, jamais des pratiques propres à une culture ne s’étaient imposées comme modèles universels aussi rapidement. Modèles qui sont aussi politiques et économiques; par exemple, la démocratie parlementaire et l’économie de marché admises désormais presque partout comme « rationnelles », « naturelles », et qui participent, de fait, à l’occidentalisation du monde.
Pour créer une demande mondiale de produits américains, les besoins doivent être à la même échelle. Pour les grandes marques telles que Coca-Cola, Malboro, Nike, Hershey, Levi’s, Pespi, Wrigley ou encore McDonald’s, vendre des produits américains, c’est vendre l’Amérique : sa culture populaire, sa prospérité et son imaginaire. Le marketing porte autant sur les symboles que sur les biens et il ne vise pas à commercialiser des produits, mais des styles de vie. Les ventes de Coca-Cola ont peu d’avenir chez les buveurs de thé : en Asie, la firme d’Atlanta a déclaré la guerre à la culture indienne du thé. Dans la culture du fast-food, le travail est primordial et les relations humaines secondaires, le rapide prend le pas sur le lent, et le simple l’emporte sur le complexe. Avec la mondialisation et surtout l’importance nouvelle des moyens de communication de masse, une donnée fondamentale a changé. Autrefois, on parlait volontiers de cultures nationales fortes auxquelles on était naturellement porté à emprunter des coutumes ou des habitudes alimentaires qui s’imposaient comme les plus intéressantes. Aujourd’hui, ce sont surtout les nations qui possèdent la technologie (cinéma, télévision), qui imposent le plus facilement leurs valeurs et leurs cultures. À la place des anciens besoins satisfaits par les produits nationaux naissent des besoins nouveaux qui réclament pour leur satisfaction les produits des pays et des climats les plus lointains. Il se développe un commerce généralisé, une interdépendance généralisée des nations et ce qui est vrai de la production matérielle ne l’est pas moins des productions de l’esprit. Dans un monde où les frontières s’ouvrent de plus en plus sous les pressions de la mondialisation de l’économie, la préservation des diversités culturelles suscite des réactions contrastées.
Pour les uns, il faut s’ouvrir sur le monde et cesser
de vouloir protéger à tout prix un folklore dépassé.
Pour d’autres, la menace d’un impérialisme américain
est réelle et les politiques de protection culturelle sont nécessaires.
Certains spécialistes nous disent que cette mondialisation ne fait
pas disparaître les habitudes, les produits et les modes de vie qui
forment le propre de la culture des diverses nations, mais qu’elle donne
aux habitants du globe un plus large éventail de choix. Ils affirment
que la présence et la promotion de différents modèles
de vie ne détruisent pas le modèle plus traditionnel, mais qu’il
offre la possibilité aux individus de choisir des éléments
différents provenant de plusieurs modèles culturels. Pour d’autres,
la mondialisation de la culture constitue une menace claire d’hégémonie
sous l’emblème américain. La tâche de situer la
vérité entre ces deux extrêmes paraît des plus complexe
compte tenu de l’enthousiasme des tenants des deux écoles de
pensée, mais cette tâche revient néanmoins à chaque
individu qui espère mieux comprendre le phénomène de
la mondialisation.
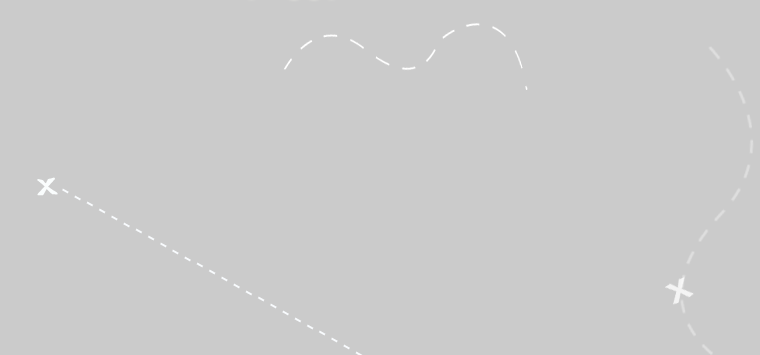 |